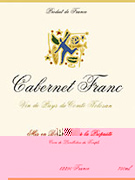Histoire du vin de Bourgogne
Le véritable essor de la qualité du vin de Bourgogne est lié à l’activité des moines bénédictins et cisterciens, au début du deuxième millénaire.
Mais l’origine de la vigne en Bourgogne est plus ancienne, L’histoire des vins de Bourgogne peut être résumée en quelques étapes importantes.
Naissance du vignoble:
La date de naissance du vignoble de Bourgogne reste floue.
Certains avancent que l’apparition du vignoble bourguignon daterait du Vlème siècle avant J.C, d’autres entre le ler et le lllème siècle après J.C, lors des invasions romaines.
Le texte le plus ancien faisant référence à la vigne et au vin de la région date de l’an 312.
Il s’agit d’un discours d’un nommé Eumene qui atteste la présence de la vigne.
Au Vlème siècle, Grégoire de Tours célèbre la côte couverte de vigne.
Premier essor, le vin des moines:
Au Xème siècle, l’aristocratie et les communautés religieuses étaient les propriétaires des vignobles.
Les moines, qui ne cherchaient pas une rentabilité immédiate, ont oeuvré avec le souci permanent d’atteindre la perfection, étude sur les meilleures souches, taille, prélèvement des boutures, greffage, méthodes de vinification, dégustations comparatives.
Leur plus grande contribution au monde du vin est l’invention de la notion de climat.
En créant les clos et la notion de climat, les moines ont donné aux vins de Bourgogne leur identité.
Deuxième essor, les Ducs de Bourgogne:
Le Premier Duc de Bourgogne est Philippe de VALOIS, dit Philippe LE HARDI, qui, par son mariage avec Marguerite de FLANDRES, à la fin du XIVème siècle, double la surface de la Bourgogne et y adjoint la Flandres.
Il a permis aux vins de Bourgogne, connus sous le nom de vins de Beaune, d’étendre plus loin leur réputation.
En l’espace de quatre générations, les quatre Ducs de Valois,Philippe LE HARDI 1342-1404, Jean SANS PEUR 1371-1419, Philippe LE BON 1396-1467 et Charles LE TEMERAIRE 1433-1477)ont fait de la Bourgogne un état totalement indépendant du Royaume de France, et dont la puissance et la prospérité ont valu pour un temps au vin de Beaune de devenir le plus célèbre vin du monde.
Par ailleurs, n’ayant aucun débouché fluvial efficace, la recherche de la qualité était indispensable pour que le prix du vin soit supérieur à son prix de transport.
De sorte que les Ducs ont édictés quelques règles destinées à garantir un bon niveau de qualité aux vins de leur région.
Les moines avaient fait du vin de Bourgogne un grand produit, mais austère et fermé.
Les grands Ducs en ont fait un produit brillant, ouvert, à la mode. Un produit de commerce haut de gamme pour l’exportation.
Le 18ème siècle et le rôle des négociants:
l’amélioration du réseau routier au XVIII ème siècle a considérablement favorisé les échanges commerciaux avec Paris et, par l’intermédiaire des grands ports d’Europe du nord, avec le reste du Monde.
Les premiers négociants étaient de simples commissionnaires.
Mais à la fin du XVlllème siècle, certains d’entre eux ont pu s’installer vraiment et donner aux vins qu’ils stockaient dans leurs caves, tous les soins nécessaires fûts neufs, soutirage, élevage.
Peu à peu est venue l’habitude de produire des vins de plus longue garde avec l’usage de la bouteille en 1750.
Le grand essor date du 19ème siècle
Pour le vignoble de Bourgogne, le XIXème siècle 1789-1914, est le symbole du progrès et celui de l’essor.
A la Révolution, la confiscation des terres de l’Eglise par l’Etat, et leur revente aux enchères comme biens nationaux, sont à l’origine de l’actuel morcellement des vignobles.
Dans le courant du XIXème siècle, l’expansion du commerce des vins de Bourgogne est étroitement liée au développement des transports et du libre échange.
– ouverture du canal de Bourgogne en 1832,
– création de la voie de chemin de fer entre Paris et Dijon en 1851,
– traité de libre échange du Second Empire avec l’Allemagne, la Belgique, la Hollande et la Grande-Bretagne.
Mais en 1875, le phylloxéra apparaît en Bourgogne et décime le vignoble?
Les garanties de la qualité:
Naissance des Appellations d’Origine Contrôlées appelées A.O.C :
A la reconstitution du vignoble au début du XXème siècle, les vins de Bourgogne se sont trouvés en position de concurrence déloyale, ce qui a valu la mise en place d’un cortège de lois en 1905, 1919 et enfin la création de l’I.N.A.O. en 1935 dont la réglementation détermine toujours aujourd’hui les conditions de production de nos vins.
Appellations Bourgogne, unité dans la diversité
Sur l’ensemble de la zone viticole il y a 8.000 hectares de vignes principalement en pinot noir pour les vins rouges, et en chardonnay pour les blancs.
Elles produisent les appellations régionales Bourgogne sous différentes formes.
Ces appellations régionales appelées aussi génériques occupent la plus grosse surface du vignoble et représentent donc le plus gros volume, environ plus de la moitié des quatre étages qui composent la pyramide des vins de Bourgogne.
Etages qui sont les appellations régionales, les appellations villages, les appellations premiers crus et enfin les grands crus soit 1% de la production.
Les appellations régionales qui portent le nom de Bourgogne ont l’unicité dans la diversité.
Diversité de couleurs, de cépages et diversité des terroirs sur les 200 kms avec coupure de zones de production.
Les Bourgognes rouges aux arômes et structures très différents selon les lieux où ils sont produits sont issus du pinot noir en grande majorité
Le Bourgogne blanc issu pratiquement exclusivement aujourd’hui du cépage chardonnay est de loin beaucoup plus répandu que l’AOC rouge.
Malgré les grandes variétés de production,il possède une sorte de constante du fait du cépage unique.
Souple, mais relativement gras, avec un équilibre en bouche qui révèle des arômes de fleurs d’acacia, de fleurs séchées et le plus souvent de pain grillé.
Le Bourgogne rosé que l’on peut aussi appeler bourgogne clairet , de couleur pétale de rose est beaucoup plus charpentés voire tannique que ses cousins du midi.
Le Bourgogne passetoutgrain, ou passe-tout-grains provient de l’assemblage de raisins de pinot noir et de raisins de gamay.
Tendre et souple c’est un vin à boire rapidement après la mise en bouteille.
Le Bourgogne aligoté est à boire jeune, parce que c’est à ce moment qu’il exprime le mieux les arômes du cépage dont il porte le nom.
c’est un vin vif et nerveux, avec une pointe d’acidité qui peut surprendre en première bouche, mais qui exprime une réelle fraîcheur.
On retrouve cette diversité dans la volonté des vignerons de certains finages d’obtenir, à côté du nom «Bourgogne», la mention de leur provenance d’origine.
Ces labels sont aujourd’hui nombreux.
Hautes Côtes de Nuits
Les premiers à obtenir ces mentions complémentaires furent les vignerons de ce que l’on appellait naguère un peu péjorativement «l’arrière Côte», c’est à dire les contreforts des côte de Nuits et côte de Beaune.
Le Bourgogne Hautes-Côtes de Nuits donne des vins rouges et blancs, mais ce sont les blancs, issus du cépage chardonnay qui donnent les meilleurs résultats.
Hautes Côtes de Beaune
Le Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune, provient de vignobles plus au sud, situés sur 20 communes de Côte d’Or et Saône-et-Loire, au «dessus» de la Côte de Beaune.
Ici ce sont les rouges qui obtiennent les meilleurs résultats. Il donne des vins rouges bien structurés gustativement charpentés, souvent assez taniques
En blanc, Ils oscillent entre noisette et pointe de beurre, entre miel et fleurs blanches.
Bourgogne Côte Chalonnaise.
La Côte Chalonnaise bénéficie de l’appellation régionale Bourgogne mais à leur tour les vignerons ont obtenu que les vins retenus par une commission d’agrément pour leur typicité puissent porter en complément du nom Bourgogne.
La mention Côte Chalonnaise 44 communes, des canton de Chagny, de Givry, de Buxy et de Mont-Saint-Vincent, peuvent proposer des vins.
Les rouges, nés du pinot noir sont d’une grande souplesse de tanins et d’une belle finesse.
Les blancs, issus de cépage Chardonnay ont des arômes de fleurs fraiches et de fruits secs.
La Bourgogne viicole
La Bourgogne viticole telle que l’a délimitée un jugement du Tribunal de Dijon de 1930 , comprend 5 grandes zones viticoles, Chablis et l’Yonne au nord, qui «encadrent» la Côte de Nuits, la Côte de Beaune, la Côte Chalonnaise et le Mâconnais.
Mais la rigueur des textes n’évoque ni le charme de ces régions, ni le talent de ceux qui font et élèvent ces vins.
De l’or au bout des ceps.
Secteur solitaire considéré comme porte nord de la Bourgogne,le Vignoble de Chablis en est aussi sa porte d’or.
Sur une superficie de plus de 2300 hectares, le vignoble de Chablis s’étend dans l’Yonne sur 20 communes autour de sa capitale Chablis.
Planté uniquement en cépage Chardonnay qui l’on nomme encore là-bas le Beaunois , ce vignoble se décline depuis 1938 en 4 appellations hierarchiques, qui correspondent à des situations, des sous-sols et des superficies totalement différentes.
Petit Chablis est qualitativement l’appellation de base. Elle est peu étendue, convrant moins de 150 hectares et du fait de l’apect dévaluant du terme petit elle est pratiquement tombée en sommeil.
Chablis est la plus grosse appellation. Sur plus de 1500 hectares elle fournit 60% de la production totale et donne des vins de couleur pâle à reflets verts, au nez très floral.
Les premiers crus couvrent pour leur part quelque 600 hectares sur les collines de part et d’autre de la rivière locale, le Serein.
Par usage et commodité, les lieux-dits qui accueillent l’appellation premier cru ont été regroupés sous 11 dénominations principales.
Les plus connues étant Montée de Tonnere, Fourchaume et Mont de Milieu sur la rive droite du Serein et Montmains, Vaillon et Côte de Lechet sur la rive Gauche.
Enfin le Chablis grand cru est la Rolls des Chablis. Nectars d’or à la robe élégante, au nez puissant, aux arômes de noix, de miel et de cette pierre à fusil qui en fait tout le charme, et à la bouche particulièrement racée, avec une grande longueur finale, ils sont au nombre de 7 qui ne portent plus le nom de Chablis, mais simplement le nom de la parcelle d’où ils sont originaires.
Ce sont Vaudésir, Les Preuses, Grenouilles, Les Clos, Valmur, Bougros et Blanchots.
Le grand défaut de leur qualité : il faut savoir les attendre …
Saint-Vincent Tournante
C’est le vignoble de Chablis qui recevra la Saint-Vincent Tournante des Chevaliers du Tastevin, le dernier week-end de janvier.
Quel bouquet
La Côte de Nuits, dans le paysage bourguignon, c’est un bouquet de couleurs, de senteurs, de vignerons…
Quel plaisir que celui d’hésiter sur le dossier et de consulter « les pièces » quand elles font 228 litres.
En effet, outre les Bourgognes, plutôt rouges que blancs, généralement produits dans la plaine et les appellations qui portent le nom des villages qui les soutendent, la Côte de Nuits offre une gamme étonnante de premiers crus magnifiques, et surtout de grands crus aux noms enchanteurs.
Un seul en partie blanc en partie rouge, le Musigny, tous les autres en rouge.
Marsannay, qui fut longtemps la « capitale » du rosé de Bourgogne est devenue aujourd’hui une appellation de Côte de Nuits, à part entière.
Fixin, produit des vins rouges charpentés et tannique de grande garde. Les premiers crus sont réputés
Gevrey, le village dont l’image colle au Chambertin, est celui qui produit l’appellation communale la plus importante en volume.
Les vins sont puissants mais élégants, souvent longs à se réveler, mais tellement beaux, quand, bien vinifiés, ils « arrivent » enfin.
Morey-Saint-Denis, possède 5 grands crus, qui ont la particularité d’avoir un nom spécifique qui est aussi une appellation contrôlée.
Chambolle-Musigny, commune de petite surface, mais de grande renommée, ne produit plus des vins aussi charpentés que ses soeurs plus au nord. On serait plutôt ici, dans la dentelle.
Outre ses grands crus, Chambolles-Musigny décline une gamme magifique de premiers crus dont le plus célèbre s’appelle Les Amoureuses.
Vougeot… c’est d’abord et avant tout son Clos fameux fondé au XXIe siècle, dont le château sert de chef d’Ordre à la confrérie des Chevaliers du Tastevins.
Mais ce serait dommage, même s’il est célèbre, par son histoire, ses 70 à 80 propriétaires différents, et bien sûr la qualité des vins, de réduire Vougeot à ces seuls 50 hectares.
Sur les 30 qui restent, profitent de très beaux premiers crus rouges comme le Clos de la Perrière, ou blanc le Clos blanc de Vougeot.
Flagey-Echezeaux, au bord du mur du Clos de Vougeot, n’a pas d’appellation qui porte ce nom.
Les grands crus s’appellent Echezeaux ou Grands-Echezeaux, les appellations communales portent l’étiquette Vosne-Romanée.
Solides, très structurés, de garde, ils ont le type bourguignon idéal.
Vosne-Romanée, berceau d’une multitude de grands crus sur son vignoble, propose des appellations communales et des premiers crus qui fleurent bon leurs grands frères, avec des senteurs de champignons et sous-bois, des notes parfois animale, voire viscérale très reconnaissables.
Nuits-Saint-Georges n’a pas de grands crus mais tire pourtant la réputation de la côte à laquelle on a donné le nom et une antériorité de presque un millénaire pour un vignoble qui s’étend au nord et au sud de la ville, jusqu’à Premeaux dont une partie du vignoble et notamment de très beaux premiers crusa droit à l’appellation.
Côte de Nuits-Villages.
Enfin, derniers bastions nuitons avant la Côte de Beaune, les villages de Premeaux-Prissey, de Comblanchien et de Corgoloin n’ont pas d’appellation propre, mais proposent comme une partie de Fixin et Brochon, au sud de Dijon, une appellation Côte de Nuits-Villages au coeur de laquelle on trouve de fantastiques rapports qualité-prix.
Parce que la qualité est au Top et que les prix savent encore être tirés.
Aucun autre des villages de la côte n’a droit à cette AOC.
Et il n’existe pas d’appellation Côte de Nuits.
Grands crus pléthore mais qualité:
La Côte de Nuits n’a pas de rival en Bourgogne quant au nombre de grands crus, summum de ce qui se fait en matière de réputation de qualité.
Il y en a 9 exclusivement rouges sur Gevrey-Chambertin : Chambertin avec une superficie de 30 ha, Chambertin Clos-de-Bèze de 15 ha, Latricières-Chambertin 7 ha, Charmes-Chambertin ou Mazoyères-Chambertin a 30 ha, Griotte-Chambertin 2 ha, Ruchottes-Chambertin 3 ha, Chapelle-Chambertin de ha, Mazis-Chambertin 9 ha.
Sur Morey-Saint-Denis, les grands crus sont 5, tous en rouge : Bonnes-mares a 2 ha, les 13 autres étant sur Chambolle-Musigny, Clos-Saint-Denis 6 Ha, Clos-de-la Roche 16 ha, Clos de Tart 7 ha, et Clos des Lambrays 8 ha.
Sur Chambolle-Musigny : Musigny a 10 ha en rouge surtout, mais une partie en blanc et Bonnes-Mares a 13 ha.
Sur Vougeot, 50 ha de Clos-de-Vougeot
Sur Vosne-Romanée : Romanée-Conti a 1 ha 81, Richebourg a 8 ha, la Romanée 0,85 ha, La Tâche 6 ha, Romanée-Saint-Vivant 9 ha, ainsi que Grands-Echezeaux 9 ha, et Echezeaux 36 ha.
De part et d’autre de la Capitale
Un vignoble de grands blancs encadré par de grands rouges, la Côte de Beaune descend de Corton jusqu’aux Maranges en passant par le Montrachet.
15 villages en Côte d’Or et quatre en Saône-et-Loire composent la Côte de Beaune qui prend au nord le relais de la Côte de Nuits de part et d’autre de Beaune la Capitale historique du Bourgogne qui lui donne son nom.
Si du côté des appellations villages, quand elles portent le nom de leur commune, des premiers crus et grands crus tout est simple, ce n’est pas toujours facile de bien cerner les autres appellations, entre le Côte-de-Beaune-Villages, leVillage-Côte de Beaune, le Côte-de-Beaune et le Beaune.
Au nord de Beaune
Ladoix-Serrigny, la plus au nord de la Côte de Beaune est une commune privilégiée. Au pied est de la colline de de Corton, elle produit des AOC Ladoix et ses premiers crus vins d’une grande souplesse en rouge et d’une belle finesse en blancs mais aussi des vins d’appellation Corton en rouge et d’appellation Corton-Charlemagne en blanc particulièrement délicats et typés.
Pernard-Vergelesses, de l’autre côté de la colline de Corton fait dans la dentelle. Son Ile de Vergelesses est l’un des plus beaux premiers crus.
Aloxe-Corton perché à mi-colline est la perle du nord de cette Côte de Beaune, avec ses Aloxe-Corton et premiers crus particulièrement charpentés aux senteurs qui renardent et ses grands crus l’un blanc, l’autre rouge qui se décline en fonction des climats, tout à fait exceptionnels et racés.
Savigny-les-Beaune plus à l’ouest dans la combe de Fontaine Froide fait dit vins qu’on dit nourrissants, théologiques et morbifuges.
S’il n’y a pas de grand cru à Savigny-les-Beaune, 17 climats sont classés en premier cru.
Chorey les Beaune dans la plaine n’a pas de premier cru, mais de beaux vins rouges, peu de blancs mais élégants et souples.
Beaune.
La Capitale du Bourgogne possède de très beaux vins qui sont assez peu connus.
Sans la vente des vins des Hospices de Beaune, ils seraient même inconnus.
Pourtant la variés de vins, à dominante rouge, sur le finage de Beaune est assez étonnante.
Souples et léger côté Savigny, ils sont puissants et tanniques côté Pommard. Les premiers crus sont des raretés.
Au sud de Beaune
Pommard qui jouxte Beaune par le sud est sans doute la plus médiatique des appellations de Bourgogne.
Très concentrés, particulièrement longs en bouche, les vins d’appellation Pommard village sont en quasi unanimité rouges.
Tout comme les premiers crus, qu’ils soient Rugiens Grands Epenots ou Clos de la Commaraine.
Volnay est une sorte d’opposé de Pommard qui lui est pourtant limitrophe.
Ses vins, dans la gamme desquelles on compte 35 premiers crus dont Les Champans, le Clos des Chène ou les Caillerets, sont d’une grande finesse, d’une délicatesse sans égal et peu corsés.
Monthelie au nord de Volnay et à l’ouest de Meursault fait mieux que vivre à la frontière des grands rouges et des grands blancs.
Le vignoble donne des vins pleins de charme et typés avec des nuances d’arômes plaisantes.
Auxey-Duresses, dans la combe à l’ouest jouxte Meursault et donne quelques blancs aux arômes de pomme golden, et des rouges aux senteurs animales.
Saint-Romain, au pied des falaises est un sanctuaire à blanc. Très sec avec des senteurs de fleurs blanches et d’agrumes, et une terre à rouges aux arômes de griotte.
Meursault.
Même si, en entrant par Volnay, on tombe » sur les rares Meursault rouges qu’on appelle Volnay-Santenots, et même si, en partant vers Puligny on quitte la commune sur les rares Meursaults rouges nommés Blagny, Meursault est sans conteste la capitale des vins blancs de Bourgogne, toutes zones confondues.
Les villages sont élégants, fins, de belle origine. Les premiers crus dont les plus connus sont Les Genevrières, Les Charmes, Les Perrières, les Gouttes d’Or etc… sont secs et moelleux, fin et gras, onctueux et longs en bouche. En tout cas à garder.
Puligny-Montrachet renoue avec les grands crus disparus depuis Corton. Des blancs archidominants sont intenses, avec des arômes d’amande et de miel affirmés. La commune partage avec Chassagne les grands crus de ce secteur.
Chassagne-Montrachet. Si le nord du vignoble est celui des grands blancs, au sud du village ce sont les rouges, superbes, très marqués et élégants qui dominent.
Saint-Aubin est le prolongement ouest de Puligny et de Chassagne. Si les rouges sont plus présents, ce sont les blancs qui s’y expriment le mieux. Notamment en premiers crus particulièrement arômatiques.
Santenay enfin, ferme la Côte d’Or viticole mais partage avec Remigny, en Saône-et-Loire un vignoble qui compte une douzaine de premiers crus bien charpentés, et aux senteurs de violette et de confiture de fraise.
Maranges est l’appellation regroupée depuis 1989 des vins produits sur les communes de Cheilly… Dezize et Sampigny-les-Maranges, au bord de la Cozanne. Les rouges sont dominants. les premiers crus font des vins typés, souples et frais.
Hospices de Beaune
La plus célèbre vente de charité du monde.
C’est en 1443 alors que le pays subit de plein fouet les effets de la guerre de Cent Ans que Nicolas Rolin, chancelier du Duc de Bourgogne, signe la charte de fondation au coeur de Beaune, d’un hopital destiné, non seulement aux malades, mais aussi aux pauvres et aux nécessiteux. L’Hôtel-Dieu était né.
Au fil des siècles il s’impose par son esprit de charité. Grâce aux dons de généreux bienfaiteurs, le domaine viticole est magnifique.
Sur Beaune, bien sûr, mais aussi sur de nombreuses communes voisines. Jusqu’à la Révolution, où l’Hotel-Dieu devient Hospice d’Humanité, les vins sont vendus à l’amiable.
Après 1794, et avec l’apparition des négociants, la vente se fait par soumission. La première vente aux enchères se fit en 1859 dans la cuverie des Hospices.
En 1924, elle fut définitivement fixée au troisième dimanche de novembre…
Rouges élégants, blancs parfumés
Rouges élégants, blancs parfumés dans une tradition de qualité. La Côte Chalonnaise fleure bon le terroir.
La Côte Chalonnaise s’étend sur 25 kms de long, entre Chagny aux portes de la Côte d’Or et Saint-Gengoux-le-National, et se situe dans le prolongement naturel des grands terroirs de la Côte de Beaune.
Dans cet environnement géologique privilégié, la Côte Chalonnaise propose une gamme très diversifiée, et particulièrement harmonieuse d’appellations régionales Bourgogne, Bourgogne, Bourgogne Passetoutgrains, Bourgogne Aligoté, Bourgogne grand ordinaire, ponctués depuis l’an passé par 5 ilots réputées puisqu’à Rully, Mercurey, Givry et Montagny, est venu s’ajouter l’an dernier Bouzeron passé du statut de Bourgogne labelisé à celui d’appellation village.
Label Bourgogne Côte Chalonnaise
La Côte Chalonnaise bénéficie de l’appellation régionale Bourgogne, pour les vins rouges, blancs et rosés.
Mais estimant qu’il était nécessaire, devant la grande diversité géographique des appellations Bourgogne que les consommateurs puissent identifier clairement la provenance de celles de leur secteur, les vignerons ont obtenu que les vins retenus par une commission d’agrément pour leur typicité puissent porter en complément du nom Bourgogne, la mention Côte Chalonnaise devenue un label.
44 communes, 11 dans le canton de Chagny, 12 dans le canton de Givry, 18 dans le canton de Buxy et 3 dans le canton de Mont-Saint-Vincent, peuvent présenter à cette commission des vins issus de leurs vignobles.
Aujourd’hui, les vins Bourgogne-Côte Chalonnaise, entrent sur les marchés avec l’un des plus beaux rapports qualité-prix que l’on puisse trouver.
Parce que le prix est des plus raisonnables, mais aussi parce que la qualité n’a plus rien à envier aux Bourgognes produits dans les finages de Côte d’Or.
Les rouges, nés du pinot noir sont d’une grande souplesse de tanins et d’une belle finesse.
Les blancs, issus de cépage Chardonnay ont des arômes de fleurs fraiches et de fruits secs.
Des villages heureux:
La Côte Chalonnaise est la terre de 5 appellations villages de très belle origine
Dans cette côte Chalonnaise, véritable colonne vertébrale des vignes de la Saône-et-Loire du nord, 5 ilots de vignobles sont classés en appellations villages avec pour certains des premiers crus.
Exclusivement blanc au nord avec l’aligoté de Bouzeron, et exclusivement blanc au sud avec le chardonnay de Montagny, le vignoble est panaché entre les deux.
Pour le plus grand plaisir des amateurs de diversité.
Bouzeron, tout au nord de l’aire de production, c’est le dernier né des villages de Côte Chalonnaise, Mais cela ne doit rien au hasard.
Bouzeron produit en effet un vin issu du cépage aligoté, l’un des plus beaux et le plus fin de Bourgogne.
Autorisé jusque là à s’appeler Bourgogne Aligoté de Bouzeron il est arrivé dans la cour des grands l’an passé. Ce n’est que justice.
A noter que c’est la seule appellation village au monde de cépage aligoté.
Rully au sud de Bouzeron est l’appellation village que portent les vignobles des communes de Rully en majorité, et Chagny et de ses terroirs, en Bourgogne on les nomme des climats qui peuvent prétendre à être classés en premier cru.
Le cépage pinot donne ici des vins rouges d’une couleur rubis pourpre élégante, aux arômes tout en finesse, ou dominent souvent le lilas et la framboise.
Rully est aussi le plus important berceau de Saône-et-Loire du Crémant de Bourgogne, vin mousseux d’appellation d’origine contrôlée élaboré dans des conditions de production très strictes, particulièrement draconiennes et surveillés.
Givry c’est 200 hectares de vignoble en production, dont la quasi totalité est plantée en pinot, le cépage des vins rouges, tandis que le chardonnay, qui fait les vins blancs, y est nettement minoritaire, même si son aptitude à vieillir donne souvent de très agréables surprises.
3 communes, Givry, Dracy-le-Fort et Jambles peuvent prétendre produire du Givry ou des premiers crus de Givry.
Givry propose des vins rouges fins, particulièrement souples, rarement très taniques, mais vifs et généreux. Dans les grandes années, il peut se garder 10 à 20 ans et prend alors des senteurs étonnantes et évoluées de fruits cuits et de pruneaux.
Mercurey.
Cette appellation communale, s’étend sur 550 hectares des villages de Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu et produit des vins remarquables et remarqués, qui furent longtemps recherchés pour faire des… Chambertin.
Si la référence est prestigieuse, les vignerons de Mercurey valent mieux que de faire des succédanés de grands crus, fussent-ils prestigieux.
Ils le savent et s’y emploient. Aujourd’hui l’appellation offre une variété de villages magnifiques, et une gamme de premiers crus à faire… rougir d’envie de grandes appellations plus au nord.
En rouges, le pinot donne des vins structurés, très équilibrés, avec une grande longueur en bouche.
Des vins à laisser vieillir quelques années En blancs, le chardonnay donne aux cuvées, des arômes intenses de miel et d’acacia, avec en bouche, des senteurs secondaires d’exception.
Montagny.
Quatre communes du canton de Buxy portent les 200 hectares de vignobles de Montagny, et produisent les vins blancs issus du cépage chardonnay.
Montagny-les-Buxy qui a donné son nom au vin est à l’ouest, et regarde Buxy au nord, Saint-Vallerin est au sud et Jully-les Buxy à l’est.
Ces 4 communes limitrophes les unes des autres servent d’écrin à ce vin très clair et doré, aux reflets verts.
Car, le vignoble de Montagny, qui comporte des climats classés en premier cru, offre en fonction de l’inclinaison des terroirs, une palette enchanteresse et particulièrement… colorée de vins blancs étonnament parfumés, d’où émanent des senteurs nuancées de fougère, et de noisettes, et des arômes aux notes minérales et aux saveurs épicées.
Le Montagny, c’est un véritable bouquet de parfums, qui en vieillissant s’orne de ce petit goût de miel et de pierre à fusil si particulier qu’on le reconnaitrait entre mille.
VIN DE BOURGOGNE – Le trapèze idéal
Si Pithagore avait connu le vignoble du Mâconnais, c’est un théorème sur le trapèze idéal qu’il aurait sans doute énoncé…
Le vignoble macônnnais, tout au sud de la Bourgogne du sud est un vaste et magnifique trapèze que Pithagore, délaissant le triangle, au demeurant un peu trop réctangle aurait sans doute traduit en théorème.
Car en théorie ce trapèze qui a pour grande base la RN.6 sur les 40 kilomètres de Sennecey-le-Grand à Crêches-sur-Saône et qui a pour petite base la N.481 sur les 24 kms de Saint-Gengoux-le-National à Cluny, est une sortie de Jardin extraordinaire, pour reprendre le titre d’une chanson de Charles Trenet.
Entre mathématique pure et poésie gentille le Mâconnais est ternaire car il produit des vins rouges, rosés et blancs.
Le système d’articulation des différentes appellations Mâcon est quelque peu complexe car il faut mettre en équation les 5 crus du Mâconnais que sont Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Pouilly-Vinzelles Pouilly-Loché et Viré-Cléssé, les rouges et les rosés dénommés Mâcon, Mâcon Supérieur et Mâcon suivis du nom de leur commune d’origine.
Il faut faire la même chose avec les blancs, appelés Mâcon ou Mâcon Pinot-Chardonnay, Mâcon Supérieur, Mâcon-Villages ou Mâcon également suivis du nom de leur commune d’origine, selon des aires délimitées.
Mais,un petit verre de l’un ou l’autre après l’exercice de mémorisation remet parfaitement les esprits en place.
Mâcon rouge et rosé.
Cette appellation vient du vignoble de l’arrondissement de Mâcon, et de celui de 12 communes aux environs.
Ce sont des vins à boire jeunes, développant des arômes de fruits rouges frais avec parfois des senteurs d’épices.
Ils accompagnent à merveille les charcuteries.
Mâcon supérieur rouge et rosé.
L’étiquette de cette appellation peut porter cette mention Mâcon supérieur, ou bien le nom de Mâcon suivi du nom de la commune sur lequel il est produit.
Cela concerne les mêmes villages que ceux de l’appellation Mâcon, mais ils ne peuvent jamais s’appeler Mâcon-Villages, cette mention étant exclusivement réservée aux vins blancs.
Ce sont des vins élégants, à la robe rouge groseille, au nez fruité, souvent à dominante d’arômes exotiques.
Mâcon blanc.
Il a la possibilité de s’appeler Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Mâcon. Il est issu de l’aire de vignoble de l’arrondissement de Mâcon, et la récolte moyenne annuelle ne dépasse pas les 3.500 hl.
Léger et très frais en bouche le Mâcon blanc fait un très bon vin d’apéritif, notamment l’été.
Mâcon-Villages.
Cette appellation peut se décliner sous deux formes : Mâcon-Villages ou celle de Mâcon suivi du nom de la commune d’où il provient.
Réservée exclusivement aux blancs issus du cépage chardonnay, et produite sur 43 communes spécifiques, cette appellation se décline de plus en plus avec le nom spécifique de la commune accolé à Mâcon.
Surtout dans le triangle d’or Viré-Lugny-Chardonnay. Pour porter la mention de la commune, il faut impérativement que les raisins en proviennent.
La route des Vins
Depuis plus de 10 ans maintenant, et à l’initiative de Fernand Bucchianeri, a été mis en place un extraordinaire maillage des 65 villages viticoles du sud de Saône-et-Loire.
Entre le Circuit du Pouilly-Vinzelles et du Pouilly-Loché qui fait 10 kms et le Circuit des Mâcon en blanc et rouge et qui passe en revue 40 communes en 84 étapes, 12 boucles parfaitement détaillées répertorient, sur 500 kms, tous les itinéraires possibles. Mais aussi les vignerons particuliers, caves coopératives et caveaux où l’on peut retrouver ces nectars.
On peut se procurer les documents à l’office du Tourisme de la Route des Vins Mâconnais-Beaujolais. 8, rue Dufour à Mâcon ou par correspondance à Solutré 71960.