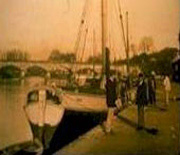CHAMPIGNONS COMESTIBLES MAIS SAUVAGES – Les agaricacées:
Il est pour le consommateur que nous sommes des moments dans notre vie qui sont inoubliables. Ce sont des rencontres qui nous sortent de notre élément naturel pour nous transporter dans une féérie presque iréelle. Avons nous rêver, faut t’ il se pincer pour revenir sur terre? La musique en général à le don de nous mettre en transe et de nous procurer des effets semblables parfois perverses. Celle que nous chante certains mets a le même pouvoir. Des produits naturels comme les champignons l’ont aussi. Pour les citer, il y a les cèpes, les morilles, les chanterelles et quelques autres comme les truffes, les reines des terroirs. Alors, comme un virtuose et son violon vous allez les chouchouter ces petits prodiges, vous allez en prendre soin comme vous le feriez pour la prunelle de vos yeux. Elles seront triées, essuyées, lavées, dessablées, et cuisinées avec tendresse, avec amours et douceurs. Elles seront égouttées, et servies presque avec recueillement. Leurs fumets parfumeront la table comme un encens pour mieux encore vous enivrer de leur parfum issu de cette nature où elles sont nées et qu’elles viennent jusque sur votre table, vous faire partager. Moments inoubliables d’un rêve rejoignant les réalités d’une perfection de la nature. Il y en a d’autres, nous avons déjà parlé, plusieurs suivront, mais nous nous attarderont à chaque fois sur ces merveilles des dieux inoubliables…
Agaricus arvensis Schaeff. ex Secr.
Nom français: Agaric des jachères
Nom anglais: Horse Mushroom
Chapeau: 4-20 cm de diamètre, globuleux à subcylindrique au début, puis s’étalant jusqu’à devenir convexe ou plan ; à surface sèche, non hygrophane, douce et presque lisse, blanche au début, se teintant de crème ou de jaunâtre au toucher ou en vieillissant, vergetée de fibrilles innées, parfois subécailleuses, jaunissant au KOH ; à marge souvent ornée de vestiges blanchâtres du voile partiel; à chair épaisse, ferme, blanche, prenant lentement une teinte jaunâtre au contact de l’air, rougissante parfois, fréquemment à odeur anisée, à saveur douce ou évoquant l’amande.
Lames: libres, serrées, assez larges, blanchâtres ou un peu grisâtres au début mais non rosées, prenant ensuite lentement une couleur brun-vineux-rosâtre terne pour finalement devenir brun noirâtre foncé.
Pied: 5-15 cm de long par 1,0-2,5 cm de diamètre, égal ou élargissant lentement vers une base un peu claviforme, farci plein au début, s’évidant ensuite, lisse ou avec de petites squamules cotonneuses sous l’anneau, blanchâtre puis se tachant de jaunâtre au toucher ou avec l’âge, brunissant même un peu à la base.
Voile: Voile partiel formant au haut du pied un anneau double, membraneux, lisse et soyeux au-dessus, recouvert de plaques cotonneuses au-dessous, blanc ou teinté de jaunâtre avec l’âge.
Spores: ellipsoïdes à ovoïdes, lisses, 7,3-10,6 x 5,0-6,3 µm, non amyloïdes. Sporée brun pourpré foncé.
Habitat: Solitaire, dispersé ou en petits groupes, sur le sol dans les endroits herbeux ? gazons, pâturages, bosquets ; en fin d’été et en automne.
Comestibilité: Excellent
Agaricus campestris L. ex Fr.
Nom français: Agaric champêtre
Nom anglais: Meadow Mushroom
Chapeau: 4-10 cm de diamètre, au début presque rond et un peu écrasé au centre, puis convexe et finalement presque étalé ; à surface sèche, lisse soyeuse et blanche, ou encore parsemée de grosses écailles brunâtres ou rougeâtres sur fond blanchâtre ; à marge enroulée, puis droite et prolongée ou appendiculée ; à chair épaisse, ferme, blanche, rosâtre sous la cuticule, rosissant un peu à la cassure ; à odeur et saveur douces et agréables.
Lames: libres, serrées, larges, roses au début, puis devenant brun pourpré à brun chocolat et finalement brun noirâtre.
Pied: 2-6 cm de long par 1,0-1,5 cm de diamètre, court, égal ou un peu aminci vers la base, plein, puis farci et creux, blanc, lisse au-dessus de l’anneau, parfois un peu fibrilleux en dessous.
Voile: Voile partiel laissant au milieu du pied un anneau simple, membraneux, à rebord lacéré ou frangé, bientôt affaissé, souvent fugace.
Spores: ellipsoïdes, lisses, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Sporée brun pourpre à brun chocolat foncé.
Habitat: Dispersé ou en groupes, formant parfois des arcs ou des cercles dans l’herbe des pâturages ou sur les gazons, de la mi-août jusqu’en octobre.
Comestibilité: Excellent.
Remarque: On le distingue de l’agaric des jachères, une espèce rencontrée dans le même habitat, par son pied court, son anneau simple et fugace, son chapeau et son pied qui ne jaunissent pas et l’absence d’odeur d’anis.
Cystoderma amianthinum (Fr.) Fayod
Nom français: Cystoderme couleur d’amiante
Nom anglais: Pungent Cystoderma
Chapeau: 2-5 cm de diamètre, conique ou convexe mamelonné, puis de plus en plus aplati, parfois radialement ridé, jaune ocré, chamois, ocre brunâtre ; à surface sèche, couverte de granules serrés au centre, plus espacés à la marge ; à marge appendiculée de lambeaux du voile ; à chair mince, jaunâtre, à odeur faible ou désagréable, à saveur faible. La cuticule du chapeau vire au brun-rouge sous l’action du KOH.
Lames: adnées, serrées, assez larges, blanches devenant jaune crème, à lamellules intercalées.
Pied: 3-7 cm de long par 3-8 mm de diamètre, égal ou un peu élargi à la base, farci puis creux, concolore au chapeau et guêtré de flocons ou granules sous l’anneau floconneux et fugace, jaunâtre et pruineux ou fibrilleux au-dessus, souvent enveloppé à la base de mycélium blanc.
Voile: formant un anneau floconneux fugace sur le pied et laissant des lambeaux à la marge du chapeau.
Spores: ellipsoïdes, 5-7 x 3-4 µm, amyloïdes. Sporée blanche.
Habitat: Solitaire, dispersé, ou en petits groupes, parmi les mousses dans les bois de conifères ou mêlés, en été et en automne.
Comestibilité: Comestible mais non recommandé vu sa petite taille et les risques de le confondre avec des espèces vénéneuses.
Lepiota clypeolaria (Bull. ex Fr.) Kumm.
Nom français: Lépiote en bouclier
Nom anglais: Shaggy-stalked Lepiota
Chapeau: 2-8 cm de diamètre, hémisphérique campanulé au début, puis conique campanulé, finalement conique aplani et obtusément umboné ; à surface sèche, lisse à croûteuse, brun ocre à brun roussâtre au centre, à cuticule séparable de la marge jusqu’au milieu et se déchirant du pourtour du mamelon jusqu’à la marge en fines squamules ou écailles brun ocre dressées et disposées concentriquement, souvent plus pâles vers la marge, sur fond crème visible entre les squamules ; à marge appendiculée, floconneuse au début, striée et incise en vieillissant ; à chair blanche à blanchâtre, mince, à odeur douce ou quelques fois aromatique fongique agréable, à saveur douce de champignon.
Lames: hygrophanes, gris blanc par temps humide, blanches ou crème par temps sec, libres, serrées, légèrement crénelées floconneuses à l’arête.
Pied: élancé, 4-10 cm de long par 0,3-0,8 cm de diamètre, égal ou un peu épaissi ou clavé vers la base, rigide mais cassant, creux, couvert sauf au sommet d’un manchon de fibrilles ou de flocons laineux blanc jaunâtre, la partie inférieure du pied brunissant avec l’âge.
Voile: Voile partiel laissant des lambeaux floconneux à la marge du chapeau et un faible anneau fibrilleux contonneux au haut du pied.
Spores: fusiformes ou en amande, 11,5-16 x 4,5-6,3 µm, lisses, hyalines, dextrinoïdes. Sporée jaune crème.
Habitat: Solitaire, dispersé ou en petits groupes sur le sol dans les bois de conifères ou mêlés, en fin d’été et en automne.
Comestibilité: On le dit vénéneux ; toutes les lépiotes élancées devraient être évitées.
Lepiota cortinarius Lange
Nom français: Lépiote cortinaire
Nom anglais: Cortinarius Lepiota
Chapeau: 3-10 cm de diamètre, campanulé, puis étalé mamelonné ; à marge incurvée, débordante ; à disque central brun foncé, crouteux, plus ou moins craquelé et tout autour à cuticule rompue en petites squamules granuleuses ou en flocons brun roux, palissant vers la marge et disposés concentriquement sur fond blanchâtre ; à chair ferme, blanche, épaisse au centre, sans odeur ni saveur prononcées.
Lames: libres, serrées, assez larges, ventrues, blanchâtres, jaunâtres à la fin, denticulées à l’arête.
Pied: 5-9 cm de long par 0,7-1,5 cm de diamètre, égal ou élargissant vers la base, se terminant en un petit bulbe, creux, couvert de fibrilles ou de flocons laineux blanchâtres sur fond de plus en plus brunâtre vers la base.
Voile: Voile partiel cortinoïde, évanescent, laissant sur le pied un anneau fibrilleux ou semi-membraneux.
Spores: ovoïdes, un peu tronquées à la base, 7-9 x 3-4,5 µm. Sporée blanche.
Habitat: Dispersé ou en petits groupes sur le sol sous les conifères, en fin d’été et en automne.
Comestibilité: Phillips le dit vénéneux, mais Pomerleau rapporte que des amateurs le consomment. La question de comestibilité est toujours délicate car la toxicité varie beaucoup d’un individu à l’autre et souvent selon le degré de cuisson.
Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Sing.
Nom français: Lépiote jaune
Nom anglais: Yellow Parasol, Flower Pot parasol
Synonyme: Lepiota lutea
Chapeau: 2,5-6 cm de diamètre, ovale, puis conique évasé ou campanulé, finalement étalé-omboné ; à surface sèche, poudreuse, farineuse et/ou finement écailleuse, habituellement plus écailleuse et moins poudreuse avec l’âge, jaune vif à jaune citron ou jaune pâle, parfois brune ou chamois sur le disque ; à marge profondément striée, surtout à maturité alors que les stries atteignent presque le centre ; à chair très mince, jaune.
Lames: libres, étroites, serrées, jaune ou jaune pâle.
Pied: 3-10 cm de long par 1,5-5 mm de diamètre, élargissant près de la base, sec, lisse ou poudreux comme le chapeau, jaune, muni d’un anneau membraneux.
Voile: formant un anneau membraneux, parfois fugace, ressemblant à un collet autour de la partie supérieure du pied.
Spores: elliptiques, 8-13 x 5,5-8 µm, lisses, dextrinoïdes, à paroi épaisse, avec un pore germinatif distinct. Sporée blanche.
Habitat: Solitaire, en groupes ou en touffes, on peut le rencontrer en tout temps dans les serres ou dans les pots à fleurs à l’intérieur.
Comestibilité: On le dit toxique pour certaines personnes.
CHAMPIGNONS COMESTIBLES MAIS SAUVAGES – Les Cortinariacées.
Cortinarius armillatus Telamonia
Nom français: Cortinaire à bracelets, cortinaire armillé.
Nom anglais: Bracelet Cort
Chapeau: 5-13 cm de diamètre, convexe ou campanulé, puis étalé avec un large mamelon obtus ; à surface sèche ou légèrement hygrophane, fibrilleuse, squamuleuse avec l’âge, brun rougeâtre à orange brunâtre ou fauve ocré ; à marge incurvée puis étalée, ornée de vestiges du voile partiel ; à chair épaisse, blanchâtre à brunâtre, à odeur faible de radis et à saveur faible ou un peu amère.
Lames: adnées à adnexées, larges, espacées, crème au début, puis cannelle et finalement brun rouille.
Pied: 7-15 cm de long par 1-2,5 cm de diamètre, robuste, claviforme ou avec un bulbe allongé, plein, sec, fibrilleux, blanchâtre, fauvâtre ou brunâtre, avec le plus souvent 2 ou 3 bracelets ou bandes pelucheuses rouge cinabre en dessous de la cortine.
Voile: Voile universel laissant sur le pied 1 à 3 bracelets rouge cinabre ; voile partiel (cortine) laissant dans la partie supérieure du pied, une zone annuliforme blanchâtre vite tachée de rouille par les spores.
Spores: elliptiques ou un peu en amande, 9-12 x 6-7 µm, rugueuses. Sporée brun rouille.
Habitat: Dispersé ou en petits groupes sur le sol, sous les bouleaux ou dans les sapinières mêlées de bouleaux, d’août à octobre.
Comestibilité: Comestible.
Cortinarius evernius (Fr.: Fr.) Fr.
(sous-genre: Telamonia)
Nom français: Cortinaire humide
Nom anglais: Wetted Cortinarius
Chapeau: 3-9 cm de diamètre, conique-campanulé, puis étalé avec un mamelon obtus, hygrophane, soyeux-fibrilleux, brun pourpré foncé lorsqu’humide, ocre rougeâtre en séchant, puis finalement beige fauve ; à marge longtemps incurvée, blanchâtre, appendiculée de lambeaux soyeux du voile partiel ; à chair mince, violacée, à odeur et saveur faibles mais parfois aussi de radis.
Lames: adnées-émarginées, très larges, espacées, pourpré-violacé au début puis virant au brun cannelle, blanchâtres et denticulées à l’arête.
Pied: 5-15 cm de long par 0,5-1,5 cm de diamètre, long, souvent irrégulier, courbé ou atténué vers la base, lilas à violacé mais plus ou moins recouvert de fibrilles blanchâtres formant bandelettes autour du pied ou lui donnant un aspect chiné, la coloration violette généralement plus foncée vers la base ; à chair pourpré-violacé avec des courants blancs.
Voile: Voile universel créant sur le pied un motif chiné ou un dégradé élégant de guirlandes apprimées blanchâtres ; voile partiel (cortine) laissant des lambeaux blanchâtres soyeux à la marge du chapeau et une zone annulaire ouateuse dans la partie supérieure du pied.
Spores: elliptiques, rugueuses, 8,5-10 x 5-6 µm. Sporée brun rouille.
Habitat: Parfois dispersé, mais plus souvent en petits groupes, même en touffes, dans la mousse de sphaigne sous les conifères, d’août à octobre.
Comestibilité: Inconnue.
Rozites caperatus (Fr.) Karsten
Nom français: Pholiote ridée, pholiote aux chèvres, rozite ridé.
Nom anglais: Gypsy Mushroom
Chapeau: 5-12 cm de diamètre, ovoïde, puis convexe-campanulé, finalement étalé et grossièrement omboné, sec, plus ou moins ridé radialement, couvert au début d’une poudre blanchâtre persistant souvent au centre, jaune ocracé à brun ocre, souvent plus pâle à la marge ; à chair épaisse, blanchâtre puis un peu ocrée, à odeur et saveur douces et agréables.
Lames: adnées à adnexées, assez larges, serrées, blanchâtres, puis jaune argileux et brun ocré, denticulées à l’arête.
Pied: 5-12 cm de long par 1-2,5 cm de diamètre, robuste, ferme, plein, égal ou souvent un peu bulbeux à la base, muni d’un anneau membraneux blanchâtre persistant, fibrilleux-squameux au-dessus de l’anneau, fibrilleux soyeux-strié en-dessous, la base souvent couverte d’un rudiment de zone volvaire.
Voile: Voile universel laissant sur le chapeau une pruine blanchâtre plus ou moins persistante et, à la base du pied, un rudiment de zone volvaire ; voile partiel laissant dans la partie supérieure du pied un anneau membraneux persistant.
Spores: elliptiques, rugueuses, 11-14 x 7-9 µm. Sporée brun rouille.
Habitat: Solitaire, dispersé ou en groupes dans la mousse verte sous les conifères, particulièrement sous les épinettes noires, de la fin juillet au début d’octobre.
Comestibilité: Excellent comestible.
CHAMPIGNONS COMESTIBLES MAIS SAUVAGES – Clavaires
Nom français: Clavaire crêtée
Clavaires et analogues
Clavariadelphus ligula (Sch.: Fries) Donk
Nom français: Clavaire petite langue
Nom anglais: Strap Coral
Fructification: en forme de massue ou presque cylindrique, 2-10 cm de haut, 0,4-1,2 cm de diamètre, au sommet arrondi ou un peu aplati, à surface lisse ou légèrement plissée, ocre terne à jaune brunâtre, blanchâtre à la base; à chair spongieuse, blanche, à odeur faible et à saveur douce ou un peu amère.
Spores: elliptiques-cylindriques, 15-19 x 4-6 µm, lisses, non-amyloïdes. Sporée blanchâtre à jaunâtre.
Habitat: En troupes ou en touffes dans la litière d’aiguilles et les petites branches mortes sous les conifères, sous les sapins et les épinettes noires à Sept-Iles, en août et en septembre.
Comestibilité: Sans intérêt.
Clavariadelphus sachalinensis (Imai) Corner
Nom français: Clavaire fausse petite-langue
Fructification: en forme de massue ou presque cylindrique, 2,5-12 cm de haut, 0,4-2 cm de diamètre, de section ronde ou un peu comprimée, au sommet arrondi ou un peu aplati, parfois obtusément pointu; à surface lisse ou légèrement plissée, ocre terne à jaune brunâtre, la partie inférieure développant une teinte ocre cendré-rosé avec l’âge, orné à la base de mycélium blanc; à chair spongieuse, blanche.
Spores: elliptiques-cylindriques ou en forme de gousse de pois, 18-23 x 4,5-5,5 µm, lisses, non-amyloïdes. Sporée blanchâtre à jaunâtre ocracé.
Habitat: En groupes ou en touffes dans la litière d’aiguilles sous les conifères, sous les sapins et les épinettes noires à Sept-Iles, de juillet à septembre.
Comestibilité: Inconnue.
Commentaire: Macroscopiquement cette espèce rare est à peu près identique à la précédente, Clavariadelphus ligula, une espèce beaucoup plus commune; cependant au microscope elle s’en distingue par ses spores plus longues.
Clavulina cristata (Fr.: Fr.) Schroeter
Nom français: Clavaire crêtée
Nom anglais: Crested Coral
Fructification: coralloïde, 2-7 cm de haut et jusqu’à 5 cm de large, formée de branches isolées ou naissant d’un tronc commun; aux branches lisses ou un peu sillonnées, plusieurs fois ramifiées vers le sommet, souvent comprimées, blanchâtres à crème ou ocracées, aux extrémités terminées par plusieurs petites dents en forme d’aiguillons, la fructification entière souvent colonisée par un parasite qui lui confère alors une teinte grisâtre à gris-lilas; à chair cassante, blanche, à odeur faible et à saveur douce.
Spores: subglobuleuses, 7-11 x 6-10 µm, lisses, non-amyloïdes, avec une grosse goutte. Sporée blanchâtre. Basides bisporées.
Habitat: Dispersé ou en groupes dans la mousse et la litière d’aiguilles, sous les conifères ou en forêt mixte, d’août à octobre.
Comestibilité: Comestible.
Commentaires: Selon certains auteurs la clavaire cendrée, Clavulina cinerea, ne serait qu’une forme de la clavaire crêtée lorsque cette dernière est parasitée par le champignon microscopique Spadicioides clavarium.
Ramaria flaccida (Fries) Ricken
Nom français: Clavaire molle ou ramaire molle
Nom anglais:
Fructification: coralloïde, 2-6 cm de haut et jusqu’à 5 cm de large, ocre à jaune-brun, constituée d’un tronc de 5-10 mm de large, feutré de mycélium blanc à sa base, duquel partent des branches à leur tour ramifiées et le plus souvent terminées par deux pointes concolores; à chair tenace, flasque, blanchâtre à jaunâtre, à odeur faible et à saveur un peu amère.
Spores: elliptiques, verruqueuses, 7-8 x 3,5-4 µm, non amyloïdes. Sporée jaune.
Habitat: Le plus souvent en groupes sur le tapis d’aiguilles sous les conifères, particulièrement les sapins et les épinettes, en août et en septembre.
Comestibilité: Comestible médiocre.
Gomphidius glutinosus Fr.
Nom français: Gomphide glutineux
Nom anglais: Slimy Gomphidius
Chapeau: 3-12 cm de diamètre, convexe, étalé , parfois déprimé, glabre, lisse, glutineux, brillant au sec, de couleur variable: brun grisâtre à gris pourpré, cannelle-grisâtre pâle à brun vineux, typiquement parsemé de petites taches noires avec l’âge ; à marge étalée puis retroussée ; à chair épaisse, molle et spongieuse, blanchâtre, brunâtre sous la cuticule, à odeur faible et à saveur douce, fade.
Lames: arquées-décurrentes, espacées, épaisses, céracées, quelques unes fourchues, inégales, blanchâtres puis grises, gris noirâtre à la fin.
Pied: 4-10 cm de long par 0,7-2 cm de diamètre, égal, amincissant généralement vers la base, plein, glabre ou un peu fibrilleux, fortement visqueux, blanchâtre au sommet et jaune citron à la base, muni juste au-dessous des lamelles d’une zone annulaire blanche au début puis noircie par le dépôt des spores.
Voile partiel: laissant une zone annulaire visqueuse incolore juste sous les lamelles, rapidement noircie par le dépôt des spores.
Spores: elliptiques-fusiformes, lisses, 15-22 x 5-7 µm. Sporée noire.
Habitat: Il croit sur le sol, principalement sous les épinettes noires et les sapins, en été et en automne. On le voit souvent accompagner le bolet glanduleux (Suillus glandulosus), parfois si près qu’ils semblent se blottir sur l’un sur l’autre.
Comestibilité: Assez bon comestible.
CHAMPIGNONS COMESTIBLES MAIS SAUVAGES – Hygrophoracées
Hygrocybe conica Sch.: Fr. Kumm.
Synonyme: Hygrophorus conicus
Nom français: Hygrophore conique
Nom anglais: Witch’s Hat, Conical Waxy Cap. Chapeau: 2-6 cm de diamètre, conique aigu ou arrondi, l’angle du cône augmentant avec l’âge tout en conservant généralement son mamelon ; à surface glabre, lisse ou radialement fibrilleuse, sèche, viscidule à l’humidité, jaune orangé ou rouge orangé, parfois avec une teinte olivâtre, se tachant de noir avec l’âge ou lorsque meurtrie ; à marge irrégulière, parfois plus longue d’un côté, festonnée, retroussée chez les vieux spécimens ; à chair mince, concolore au chapeau, noircissante, à odeur nulle et à saveur douce.
Lames: adnexées, presque libres, cireuses, larges, ventrues, assez serrées, épaisses, blanchâtres puis jaunes ou jaunâtre orangé, quelques fois gris olivâtre, noircissantes.
Pied: 3-12 cm de long par 0,4-1,2 cm de diamètre, égal, creux avec l’âge et éclatant facilement, viscidule ou non, souvent strié et/ou torsadé, jaune ou orangé, développant souvent une teinte olivâtre et noircissant, particulièrement vers la base.
Spores: elliptiques, lisses, 8-12 x 5-7 µm, non-amyloïdes. Sporée blanche.
Habitat: Solitaire ou grégaire dans les bois de conifères ou mêlés, en été et en automne.
Comestibilité: Il a longtemps été considéré comme vénéneux, mais nous savons aujourd’hui qu’il n’est pas toxique ; cependant ce n’est pas une espèce recommandée pour la consommation.
Hygrocybe miniata (Fr.: Fr.) Kumm.
Nom français: Hygrophore vermillon
Nom anglais: Vermillon Waxcap, Fading Scarlet Waxy Cap, Miniature Waxy Cap.
Chapeau: 1-3 cm de diamètre, hémisphérique au début, puis convexe à aplati, parfois un peu déprimé au centre ; à surface sèche, lisse à finement squamuleuse, particulièrement au centre, écarlate, puis rouge orangé, palissant et jaunissant avec l’âge, les squamules souvent plus pâles que le fond ; à chair très mince, fragile, plus ou moins de la couleur du chapeau, à odeur et saveur faibles.
Lames: adnées ou subdécurrentes, subespacées, tendres, cireuses, larges, épaisses, rouge orangé, jaune orangé à l’arête.
Pied: 2-5 cm de long par 2-4 mm de diamètre, égal, lisse, concolore au chapeau, jaunâtre à blanchâtre à la base.
Spores: elliptiques, lisses, 6-10 x 4-6 µm, non-amyloïdes. Sporée blanche.
Habitat: Solitaire à grégaire, au sol sous les feuillus et les conifères, en été et en automne.
Comestibilité: Comestible.
Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fries) KummerHygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.) Fr.
Nom français: Hygrophore à frange dorée
Nom anglais: Golden-spotted Waxy Cap, Flaky Waxy Cap.
Chapeau: 2,5-7 cm de diamètre, convexe, puis aplati et un peu mamelonné, lisse, collant lorsqu’humide, blanc, recouvert d’une fine couche de petits flocons jaune d’or disparaissant progressivement en ne laissant que le centre jaune ou encore seulement une bande jaune à la marge; à marge aiguë, initialement incurvée puis étalée, appendiculée de petits flocons jaunes; à chair blanche, épaisse, tendre, à odeur et saveur, faibles, douces et agréables.
Lames: décurrentes, espacées, de largeur moyenne, cireuses, blanchâtres, parfois ornées au début de flocons jaunes à l’arête.
Pied: 4-8 cm de long par 5-10 mm de diamètre, égal ou irrégulièrement déformé, plein à farci, visqueux, blanchâtre, recouvert de granules jaunes sur toute sa longueur ou encore seulement dans la partie supérieure.
Voile universel: laissant des granules ou flocons jaune d’or collants sur le chapeau et le pied.
Spores: elliptiques à ovales-allongées, 7,5-10 x 3,5-5 µm, lisses, hyalines, guttulées. Sporée blanche.
Habitat: Dispersé ou en touffes dans la litière de feuilles mortes et d’aiguilles de conifères, en forêt mixte, en fin d’été et en automne.
Comestibilité: Comestible.
Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr.
Nom français: Hygrophore à lames jaunes
Nom anglais: Pine-wood Waxy Cap, Late Fall Waxy Cap, Olive-Brown Waxy Cap
Chapeau: 2-6 cm de diamètre, conique-obtus, puis convexe, étalé et un peu mamelonné ou déprimé, viscidule, glabre, jaune olivâtre à jaune ocre, orné de fibrilles innées ocre orange surtout vers la marge, brun foncé à brun olivâtre au centre ; à chair mince, jaune sous la cuticule, blanche ailleurs, à odeur et saveur douces.
Lames: décurrentes, assez étroites, espacées ou subespacées, blanches au début puis devenant jaunâtres.
Pied: (3) 5-15 cm de long par 0,5-1,5 cm de diamètre, égal ou un peu aminci vers la base, plein ou farci, glutineux, jaunâtre ou jaune, pourvu d’une zone annulaire fibrilleuse, soyeuse, fugace.
Voile universel: laissant une couche glutineuse jaune sur le pied et une zone annulaire fibrilleuse, fugace.
Spores: ellipsoïdes 7-9 x 4-5 µm, lisses. Sporée blanche.
Habitat: Dispersé à grégaire sur le sol dans les bois de pins gris en automne.
Comestibilité: Comestible mais doux et gluant.
Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr.
Nom français: Hygrophore blanc olivâtre
Nom anglais: Sheathed Waxy Cap
Chapeau: 3-10 cm de diamètre, campanulé, puis convexe ou plat, mamelonné, très visqueux à l’humidité, fuligineux à presque noir au centre, plus pâle vers la marge (grisâtre à brun olivâtre), vergeté de fibrilles noirâtres ; à marge incurvée puis relevée, parfois prolongée par la couche visqueuse ou des gouttelettes ; à chair épaisse, tendre, blanche, à odeur et saveur douces.
Lames: adnées-décurrentes, épaisses, subespacées, blanches ou un peu grisâtres, cireuses.
Pied: 4-12 cm de long par 1-2 cm de diamètre, égal ou un peu atténué vers la base, glabre et blanc au-dessus de l’anneau, couvert d’une couche visqueuse (si humide) de l’anneau à la base et habillé de fibrilles ou marbrures noirâtres à brun grisâtre, brun olivâtre, ou grises, disposées d’une façon plus ou moins annulaire.
Voile: Voile universel laissant gluant le chapeau et la partie du pied sous l’anneau ; voile partiel fibrilleux noirâtre laissant des fibrilles ou marbrures foncées sur le pied et une sorte d’anneau de même couleur vers le sommet.
Spores: ellipsoïdes, 11-12,5(15) x 6-7(7,5) µm, lisses, amyloïdes. Sporée blanche.
Habitat: Solitaire, dispersé ou en troupes parfois nombreuses, sur le sol dans les bois de conifères ou mêlés, en automne.
Comestibilité: Bon comestible ; à la cuisson il conserve cependant une texture assez visqueuse.
Hygrophorus purpurascens (Fr.) Fr.
Nom français: Hygrophore purpuracé
Nom anglais: Purple-Red Waxy Cap
Chapeau: 4-12 cm de diamètre, convexe, puis aplani, un peu déprimé, viscidule si humide, parsemé de taches, traits ou fibrilles radiales rouge vineux sur fond rosâtre, le centre coloré d’une façon continue ; à marge moins colorée, incurvée au début ; à chair épaisse, ferme, blanche, à odeur faible et saveur douce ou amère.
Lames: adnées puis décurrentes, serrées à subespacées, étroites, blanches au début puis rosâtres, finalement parsemées de taches vineuses.
Pied: 4-12 cm de long par 1-2,5 cm de diamètre, égal ou atténué vers la base, plein, ferme, coloré ou taché comme le chapeau, sauf le haut qui demeure blanchâtre ou rosâtre, muni au sommet d’un anneau fugace ressemblant à une cortine.
Voile partiel: cortinoïde produisant au début un anneau fibrilleux incolore au haut du pied, mais disparaissant souvent rapidement.
Spores: ellipsoïdes, lisses, 5,5-8 x 3-4,5 µm. Sporée blanche.
Habitat: Dispersé ou en groupes dans la mousse à caribou sous les pins gris, durant les deux premières semaines d’octobre.
Comestibilité: Comestible si la chair est douce ; les variantes à chair amère sont immangeables car l’amertume ne disparaît pas avec la cuisson.
Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.
Nom français: Hygrophore pustuleux, Hygrophore blanc grisâtre.
Nom anglais: Grayish white Waxy Cap.
Chapeau: 1,5-4 cm de diamètre, convexe, puis convexe-aplati, parfois avec un petit mamelon, souvent un peu déprimé à la fin, viscidule, visqueux si humide, fibrilleux radialement, finement squamuleux au centre, gris cendré, gris-brun plus foncé sur le disque ; à marge aiguë, longtemps incurvée, un peu sinueuse-crénelée ; à chair blanche, épaisse au centre, mince vers le bord, à odeur et saveur douce, non-caractéristique.
Lames: subdécurrentes, subespacées, assez larges, blanches.
Pied: 3-7 cm de long par 3-7 mm de diamètre, égal ou élargissant un peu vers la base, plein ou farci, souvent courbé, viscidule à visqueux, ponctué surtout dans la partie supérieure de granules brun grisâtre sur fond blanc.
Voile universel: laissant un mince film glutineux sur le chapeau et le pied.
Spores: elliptiques, lisses, hyalines, 7,5-10 x 4-5 µm. Sporée blanche.
Habitat: Dispersé ou en groupes dans la mousse de sphaigne sous les épinettes noires, en septembre et en octobre.
Comestibilité: Comestible.
Hygrophorus speciosus Pk.
Nom français: Hygrophore remarquable
Nom anglais: Larch Waxy Cap
Chapeau: 2-5 cm de diamètre, convexe, puis étalé et un peu mamelonné ou déprimé, glutineux-visqueux, glabre, rouge orangé brillant au début devant plus pale par la suite, quelques fois orangé presque jaune près de la marge, orange foncé au centre ; à marge enroulée puis droite et étalée ; à chair tendre blanchâtre ou jaunâtre, à odeur et saveur douces.
Lames: décurrentes, assez étroites, espacées ou subespacées, cireuses, blanc jaunâtre, plus jaunes vers la marge du chapeau.
Pied: 4-10 cm de long par 0,4-1,0 cm de diamètre, égal ou un peu élargi vers la base, plein ou farci, blanchâtre ou teinté de jaune par les restes glutineux du voile.
Voile universel: laissant une couche glutineuse sur le chapeau et le pied ainsi qu’une zone annulaire fibrilleuse, fugace, jaunâtre sur le pied.
Spores: ellipsoïdes 8-10 x 4,5-6 µm, lisses. Sporée blanche.
Habitat: Dispersé à grégaire, fréquent dans la mousse, toujours lié au mélèze dans les fôrets de conifères humides et autour des tourbières, en septembre et en octobre.
Comestibilité: Comestible.
Hygrophoropsis aurantiaca (Wülf. : Fr.) Maire
Nom français: Clitocybe orangé, chanterelle orangée, fausse chanterelle.
Nom anglais: False Chanterelle
Chapeau: 3-12 cm de diamètre, convexe au début, puis rapidement déprimé et même en entonnoir ; à marge enroulée, puis incurvée, parfois lobée, ondulée ou irrégulière ; à surface sèche, veloutée ou finement feutrée, jaune orangé à orange brunâtre, souvent avec le centre beaucoup plus foncé ; à chair assez épaisse, jaunâtre ou orangé pâle, à odeur et saveur faibles ou un peu désagréables.
Lames: décurrentes, arquées, plutôt étroites, serrées à très serrées, 3-4 fois fourchues entre le pied et la marge du chapeau, sans lamellules, jaune orangé à rouge orangé vif.
Pied: 2-8 cm de long par 0,5-1,5 cm de diamètre, central ou un peu excentrique, égal ou élargi vers la base, plein, cartilagineux à coriace, finement velouté, brun orangé ou plus ou moins de la couleur du chapeau.
Spores: elliptiques, 5,5-8 x 3-4,5 µm, lisses, dextrinoïdes. Sporée blanchâtre à crème pâle.
Habitat: Solitaire, dispersé ou en groupes, sur le sol ou sur le bois très pourri, près des conifères, en été et en automne.
Comestibilité: Comestible mais avec prudence car il y a risque de confusion avec certains Gymnopilus hallucinogènes ou avec Omphalotus olearius qui est vénéneux.
CHAMPIGNONS COMESTIBLES MAIS SAUVAGES – Les lactaires.
Lactarius deceptivus Peck
Nom français: Lactaire décevant
Nom anglais: Deceptive Milky
Chapeau: 4-20 cm de diamètre, convexe, puis étalé-déprimé, finalement en entonnoir ; à surface sèche, lisse et blanchâtre avec des taches jaunâtres ou brunâtres au début, puis devenant squamuleuse à écailleuse, se tachant de brun ocre, particulièrement au centre ; à marge longtemps enroulée, cotonneuse, cachant complètement les lames au début, puis étalée ; à chair épaisse, ferme, cassante, blanche, immuable, à odeur faible puis devenant forte, à saveur âcre ; au lait abondant, blanc, âcre, immuable, tachant peu les lames en séchant.
Lames: adnées-décurrentes, serrées à subdistantes, moyennement larges, parfois fourchues, blanches au début puis crème à ocre pâle.
Pied: 3-8 cm de long par 1-3,5 cm de diamètre, robuste, égal ou atténué vers la base, sec, farci, puis partiellement creux, lisse à velouté pubescent, concolore au chapeau ou plus pâle, devenant tacheté de brun ocre.
Spores: largement elliptiques à subglobuleuses, 9-12 x 7-9 µm, échinulées, amyloïdes. Sporée blanchâtre à chamois pâle.
Habitat: Dispersé ou en groupes dans la mousse verte sous les conifères, principalement les épinettes noires, en été et en automne.
Comestibilité: Comestible lorsque bien cuit, la saveur âcre disparaissant après une bonne cuisson.
Lactarius deterrimus Gröger
Synonyme: Lactarius deliciosus var. deterrimus
Nom français: Lactaire détestable, lactaire de l’épinette.
Nom anglais:
Chapeau: 4-12 cm de diamètre, convexe, étalé, puis déprimé et même en entonnoir, glabre, un peu visqueux lorsqu’humide, zoné ou non, de couleur variable: orangé terne, carotte, brun orangé, puis se tachant de vert à la fin ; à marge enroulée au début puis droite ou relevée ; à chair granuleuse, cassante, épaisse, orangée dans le chapeau à cause du lait, blanchâtre dans le pied, tournant verdâtre à la fin, à odeur faible ou fruitée ; au lait amer, de couleur carotte, tachant les lamelles verdâtre en séchant.
Lames: adnées à décurrentes, serrées, fourchues, saumon, orangées ou carotte, se tachant de vert au froissement.
Pied: 3-7 cm de long par 1-2,5 cm de diamètre, égal ou aminci vers la base, farci au début puis creux, un peu visqueux au début puis sec, concolore au chapeau, se tachant de verdâtre, la base du pied partiellement recouverte de mycélium blanc.
Spores: elliptiques à presque rondes, 7-10 x 6-8 µ, échinulées et ornées d’un réticule partiel, amyloïdes. Sporée crème ou jaunâtre.
Habitat: Dispersé ou en groupes sur le sol sous les épinettes, en fin d’été et en automne.
Comestibilité: C’est un bon comestible, son nom est exagéré. Sa saveur amère quand il est cru se transforme à la cuisson en une saveur épicée ; il convient bien pour parfumer les potages et les sauces ou encore comme garniture sur les pizzas.
Lactarius glyciosmus (Fr.) Fries
Nom français: Lactaire odorant
Nom anglais: Sweet-scented Lactarius
Chapeau: 2-6 cm de diamètre, convexe puis étalé-papillé, déprimé et même un peu en entonnoir, squamuleux ou couvert de poils fins et mous, quelques fois un peu zoné, sec, lilas grisâtre à crème ; à marge enroulée au début puis étalée et un peu ondulée ; à chair mince, crème pâle, à odeur forte de noix de coco et à saveur âcre ou brûlante ; au lait blanc, immuable, ne tachant pas, lentement âcre.
Lames: décurrentes ou presque adnées, étroites, serrées, certaines fourchues, jaunâtre à crème pâle puis gris lilas.
Pied: 2-6 cm de long par 0,5-1 cm de diamètre, égal ou élargissant un peu vers la base, sec, glabre ou un peu duveteux, farci au début puis creux, de même couleur que le chapeau ou plus pâle.
Spores: elliptiques, 6,5-8,5 x 5-7 µm, amyloïdes, crêtées (proéminence: 0,5-0,8 µm), ornées d’un réticule partiel. Sporée crème.
Habitat: Dispersé ou en troupes sur le sol dans les boisés mixtes notamment sous les bouleaux, en fin d’été ou en automne.
Comestibilité: Comestible mais de peu d’intérêt.
Lactarius lignyotus (Fr.) Fries
Nom français: Lactaire couleur de suie
Nom anglais: Chocolate Milky
Chapeau: 2-8 cm de diamètre, convexe, puis étalé-déprimé avec une papille souvent pointue, sec, velouté, parfois ridé, brun noirâtre ou presque noir, pâlissant ; à marge initialement incurvée, souvent sillonnée ; à chair mince, blanche, rosâtre à la cassure puis brun-rosé, à odeur faible et à saveur un peu amère ; au lait blanc, abondant, immuable, tachant la chair de rose.
Lames: subdécurrentes, larges, un peu espacées, interveinées, blanches puis ocrées à la fin, rouge brunâtre aux blessures, avec une zone brune au point d’attache avec le pied.
Pied: 4-12 cm de long par 0,5-1,2 cm de diamètre, égal, parfois sillonné ou plissé au sommet, farci, velouté, concolore au chapeau, blanchâtre à la base.
Spores: rondes ou presque, 9-10,5 µm, réticulées, amyloïdes. Sporée ocre.
Habitat: Dispersé ou en groupes dans la mousse sous les sapins et les épinettes, en août et en septembre.
Comestibilité: Malgré que plusieurs auteurs disent le contraire, ce champignon s’est avéré à l’expérience être un excellent comestible.
CHAMPIGNONS COMESTIBLES MAIS SAUVAGES – Les russules.
Russula adusta Fries
Nom français: Russule brûlée
Nom anglais: Smoky Russula
Chapeau: 5-12 cm de diamètre, convexe-aplati, puis déprimé ; à surface lisse, viscidule, luisante, blanchâtre au début, puis brun rougeâtre clair, brun grisâtre, noirâtre à la fin, à cuticule à peine séparable ; à chair blanchâtre, rosissant très lentement à la coupe avant de devenir gris fumée, à odeur faible et à saveur douce.
Lames: adnées, larges, très serrées, à lamellules intercalées, blanches, puis ivoire ou jaune pâle.
Pied: 3-10 cm de long par 2-4 cm de diamètre, presque égal, robuste, dur, plein, glabre, blanchâtre, devenant brun rougeâtre au froissement ou avec l’âge.
Spores: largement elliptiques, 7-9 x 6-8 µm, amyloïdes, aux verrues proéminentes de 0,1-0,4 µm reliées par un réticule bien développé. Sporée blanche (A-B)
Habitat: Solitaire ou dispersé sur le sol en terrain sablonneux, sous les conifères, en juillet et en août.
Comestibilité: Suspectée.
Russula aeruginea Lindblad in Fr.
Nom français: Russule vert-de-gris
Nom anglais: Green Russula
Chapeau: 4-9 cm de diamètre, convexe, étalé puis déprimé, un peu visqueux si humide, brillant au sec, d’un vert variable, foncé ou grisâtre, jamais violet, parfois ocré, olivâtre, jaune-verdâtre, taché jaunâtre ; à cuticule non veloutée et séparable jusqu’à la moitié du rayon ; à marge largement arrondie, souvent striée ; à chair épaisse, ferme, blanche, modérément saumon au FeSO4, à odeur nulle et à saveur douce.
Lames: adnées, serrées, larges, cassantes, un peu fourchues près du pied, blanches devenant jaunâtres, souvent avec des taches brunes.
Pied: 4-8 cm de long par 1-2,5 cm de diamètre, égal ou aminci vers la base, plein, finement rugueux, blanc, jaunissant, la base souvent tachée ocre.
Spores: subglobuleuses, 6-10 x 5-7 µm, amyloïdes, verruqueuses-zébrées (proéminence: 0,1-0,6 µ). Sporée crème à jaune orangé pâle.
Habitat: Solitaire, dispersé ou en groupes sur le sol sous les bouleaux et les épinettes dans les bois de conifères ou mêlés, en été et en automne.
Comestibilité: Bon comestible.
Remarque: Cette espèce se distingue des autres russules au chapeau vert, par ses lames friables, sa sporée crème, sa cuticule non veloutée.
Russula decolorans (Fr. : Fr) Fries
Nom français: Russule décolorée
Nom anglais: Graying Russula
Chapeau: 5-12 cm de diamètre, subglobuleux au début, puis convexe et finalement étalé-déprimé ; à surface glabre, viscidule à l’humidité, à cuticule pelant à la marge seulement, jaune orangé, orange cuivré, brun orangé, rouge orangé, souvent un peu plus foncé au centre ; à marge lisse, puis un peu cannelée à la fin ; à chair épaisse, ferme, friable, blanche, devenant gris cendré à gris foncé à la cassure (mais parfois très lentement), à odeur faible et à saveur douce.
Lames: adnées à échancrées, assez serrées, certaines fourchues près du pied, blanchâtres, puis jaunes à ocre pâle, grisonnant avec l’âge, noircissant à l’arête.
Pied: 4-12 cm de long par 1-2,5 cm de diamètre, égal ou souvent élargi à la base, très ferme lorsque jeune, plein puis spongieux, blanc, grisonnant avec l’âge ou au froissement.
Spores: elliptiques, 9-12,5 x 7-10 µm, amyloïdes, aux verrues proéminentes de 0,7-1,5 µm et peu connexées. Sporée jaune à ocre pâle en tas (E-F).
Habitat: Isolé, dispersé ou en groupes, dans la litière d’aiguilles sous les conifères, principalement les pins, de la mi-juillet à la fin-septembre.
Comestibilité: Comestible.
Russula paludosa Britz
Nom français: Russule des marais
Nom anglais: Red-tinted Russula
Chapeau: 5-15 cm de diamètre, convexe, puis étalé et déprimé au centre, jaune orangé, écarlate, rouge sang ou rouge brique, jamais violacé, parfois à zones plus pâles ; à marge courtement cannelée avec l’âge ; à surface lisse, luisante, un peu collante lorsqu’humide ; à cuticule pelant de la moitié au 3/4 du rayon ; à chair épaisse, ferme, blanche, à odeur faible et à saveur douce.
Lames: adnées, serrées, un peu fourchues près du pied, à nombreuses lamellules intercalées, crème à jaune beurre.
Pied: 5-12 cm de long par 1,5-3,5 cm de diamètre, égal ou élargissant un peu vers la base, blanc ou partiellement ou entièrement teinté de rose, plein puis spongieux, sec, parfois un peu ridé.
Spores: ovoïdes à elliptiques, 8-10,5 x 7-8 µm, amyloïdes, à verrues de 0,7-1,2 µm de haut et à réticule partiel. Sporée ocre pâle.
Habitat: Dispersé à grégaire sur le sol humide recouvert de mousses, sous les conifères, en août et en septembre.
Comestibilité: Comestible.
Russula peckii Singer
Nom français: Russule de Peck
Nom anglais: Peck’s Russula
Chapeau: 3-12 cm de diamètre, convexe, puis étalé, finalement un peu déprimé et faiblement cannelé-tuberculeux à la marge, un peu visqueux si humide, finement velouté, un peu luisant au sec, rouge sang, rouge-rose ou écarlate ; à cuticule pelant jusqu’à la moitié du rayon ; à chair d’épaisseur moyenne, molle, fragile, rouge sous la cuticule, blanche ailleurs, à odeur faible, à saveur douce ou un peu amère.
Lames: adnées, serrées à subespacées, pas très larges, un peu fourchues près du pied, blanches puis jaunissant, denticulées à l’arête.
Pied: 5-12 cm de long par 0,8-2,5(3,0) cm de diamètre, élargissant vers la base, farci, sec, un peu ridé, blanc copieusement saupoudré de rouge ou de vieux rose.
Spores: ovoïdes à subglobuleuses, 7-9 x 6-8 µm, amyloïdes, à verrues 0,3-0,7(1,2) µm de haut, avec quelques lignes ne formant qu’un réticule partiel. Sporée blanche.
Habitat: Dispersé ou en petits groupes, sur le sol sous les conifères, en août et en septembre.
Comestibilité: Comestible, mais attendez-vous à ce que tout tourne rouge à la cuisson à cause du pigment rouge qu’il contient.
Russula puellaris Fr.
Nom français: Russule candide
Nom anglais: Ingenuous Russula
Chapeau: 3-6(8) cm de diamètre, convexe, puis étalé, finalement déprimé, un peu collant par temps humide, luisant au sec, brun vineux, rougeâtre pourpré, très foncé au centre et avec des régions délavées, ocre sale autour ; à marge cannelée-tuberculeuse avec l’âge ; à cuticule pelant de la moitié au 2/3 du rayon ; à chair mince, ferme puis fragile, blanche, à odeur faible, à saveur douce.
Lames: adnées, subespacées, larges, souvent fourchues près du pied, crème puis ocrées, brunissant ou se tachant de goutelettes brunes à l’arête.
Pied: 3-6 cm de long par 0,6-1,5 cm de diamètre, égal ou un peu clavé, plein, sec, blanc puis se tachant jaune ocre, se rompant facilement.
Spores: ovoïdes, 6,5-9 x 5,5-7 µm, amyloïdes, à grosses verrues 0,7-1,2 µm de haut, un peu zébrées (certaines spores ont peu de connexions d’autres en ont beaucoup). Sporée ocre.
Habitat: Dispersé ou en petits groupes, sur le sol dans les forêt mixtes, en été et en automne. Les spécimens de la photo ci-dessus ont été récoltés sous un bouleau blanc sur ma pelouse.
Comestibilité: Comestible.
Russula xerampelina (Sch.) Fr.
Nom français: Russule feuille morte
Nom anglais: Shrimp Russula
Chapeau: 5-15 cm de diamètre, convexe, puis aplati et déprimé au centre, sec, viscidule par temps humide, glabre, parfois finement velouté, de couleurs très variables, souvent mélangées, typiquement rouge-brun vineux, mais aussi olive brunâtre, brun jaunâtre ; à cuticule pelant sur moins du tiers du rayon ; à marge lisse, plus ou moins cannelée avec l’âge ; à chair épaisse, blanche puis jaunissant ou brunissant, à saveur et odeur douces au début, puis de crustacé (crabe) ou de poisson, devenant désagréables à la fin.
Lames: adnées à adnexées, subespacées, larges, souvent fourchues près du pied, crème pâle, puis ocrées, brunissant à l’arête.
Pied: 4-10 cm de long par 1-3 cm de diamètre, égal ou élargi vers la base, plein puis farci, blanc ou plus souvent teinté de rose, se tachant d’ocre brunâtre surtout au toucher.
Spores: elliptiques à subglobuleuses, 8-10 x 7-8,5 µm, amyloïdes, échinulées à verrues de 0,4-0,8 µm de haut, très peu zébrées. Sporée ocre (F).
Habitat: Solitaire ou dispersé, sur le sol sous les conifères, en été et en automne..
Comestibilité: Excellent comestible; le goût et l’odeur de fruit de mer disparaissent à la cuisson et laissent place à une saveur toute particulière.
Remarque: Son nom français “russule feuille morte” vient de la couleur de son chapeau qui ressemble à celle des feuilles mortes au sol.